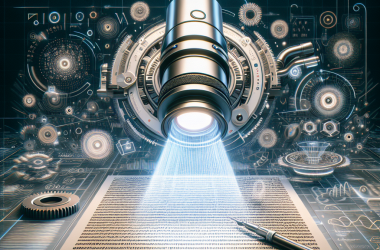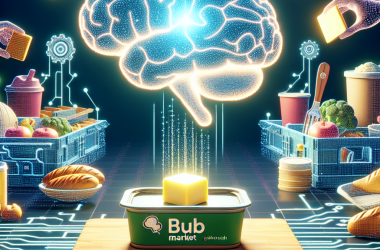Les installations de traitement de surface en France sont multiples et diversifiées, depuis les petits ateliers de chaudronnerie ayant une activité occasionnelle de traitement de surface jusqu’aux ateliers spécialisés en sous-traitance. Certaines entreprises disposent même d’un atelier de traitement de surface intégré dans leur chaîne de production. Les procédés utilisés dans ces activités vont du dégraissage, décapage, dépôt métallique (dorage, chromage dur ou décoratif), conversion ou encore démétallisation. Les pièces sont immergées dans des bains et les traitements sont appliqués par voie chimique ou électrolytique. Les techniques et les conditions d’utilisation de ces bains varient en fonction de l’activité réalisée.
L’aspect critique de ces activités réside dans les risques professionnels qu’elles présentent, ces risques dépendent de l’activité de traitement de surface en question. Les dangers liés à l’utilisation de produits chimiques, qui peuvent causer une intoxication, un incendie ou une explosion sont présents, ainsi que les risques liés aux manutentions et à l’organisation des flux qui peuvent engendrer divers troubles musculo-squelettiques comme le mal de dos. Les risques de chute et de blessures liées à l’utilisation d’outils à main ne sont pas négligeables non plus. De plus, la toxicité du bain utilisé et sa capacité à générer des émissions dans l’atmosphère de travail sont variables, dépendant de la composition du bain et des conditions de mise en œuvre.
Pour prévenir ces risques, l’évaluation des dangers est la première étape cruciale à effectuer. Cela permet d’identifier les mesures préventives les plus appropriées à mettre en place.
Pour que cette évaluation soit efficace, elle doit impliquer le personnel concerné et prendre en compte l’ensemble des activités effectuées. En fonction des risques identifiés, des mesures préventives reposant sur les principes généraux de prévention doivent être mises en place et leur efficacité surveillée. Ces mesures peuvent comprendre la suppression ou la réduction du danger, par exemple en supprimant les produits cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou les produits corrosifs, toxiques ou inflammables. La limitation des positions de travail inconfortables et le port de charges lourdes est aussi recommandée.
La mise en place de protections collectives tels que l’installation de systèmes de captage pour éviter la dispersion des émissions dans l’atelier, ou la mise à disposition de chariots spécifiques pour adapter la hauteur de travail, est également conseillée. Il est aussi nécessaire de fournir des équipements de protection individuelle adaptés, tels que des gants, des vêtements de protection, et, le cas échéant, des appareils de protection respiratoire. La prévention passe aussi par la formation et l’information des salariés sur les risques encourus et la manière de les éviter.
Pour aider les entreprises dans cette démarche de prévention des risques, l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) propose une panoplie d’outils, allant de l’évaluation des risques (Oira) à la conception des installations et à la mise en œuvre de la prévention (guide de prévention).