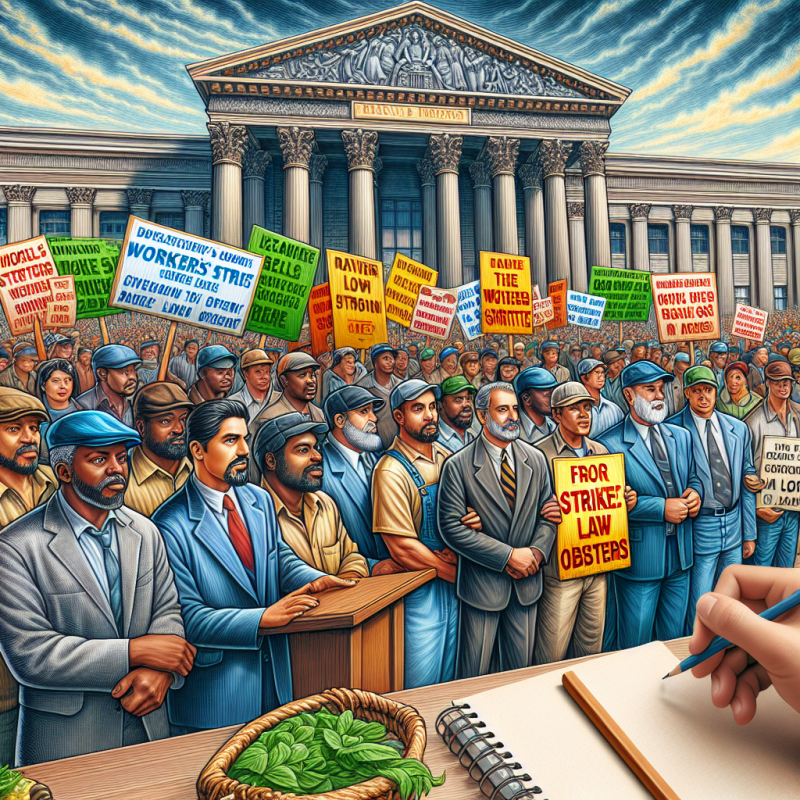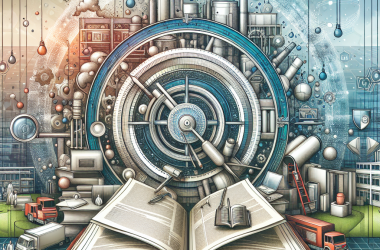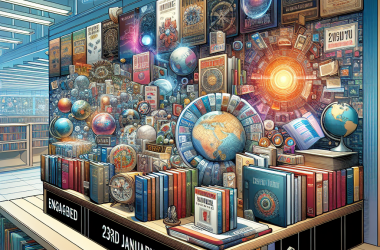L’exercice du droit de grève est un élément crucial dans le rapport de force entre l’administration et ses agents. Néanmoins, pour que ce droit ne devienne pas abusif, il est crucial de le concilier avec la continuité nécessaire de certains services publics et la préservation de l’ordre public. Dans cette perspective, le législateur a conféré aux collectivités territoriales le pouvoir de limiter en amont le droit de grève dans les services dits « essentiels ». Nous vous proposons ici de revenir sur l’encadrement de ce droit fondamental des agents publics.
Le droit de grève est indissociable de l’équilibre entre la poursuite de l’intérêt général par une collectivité publique et la liberté individuelle. Sa limitation est donc une question sensible. En absence de textes à caractère général, c’est initialement la jurisprudence qui a encadré le droit de grève dans la fonction publique.
Le législateur a cependant repris le relais et, depuis la loi du 6 août 2019 de « transformation de la fonction publique », les collectivités territoriales disposent du droit d’encadrer en amont l’exercice du droit de grève dans les secteurs dits « essentiels ». Elles ont également la possibilité, lors d’un mouvement de grève, de prendre des décisions individuelles pour assurer la continuité du service public.
“Depuis l’adoption de la loi de « transformation de la fonction publique » en 2019, les collectivités territoriales ont plus de pouvoirs pour gérer les mouvements de grève dans les secteurs essentiels.”
Il est important de noter que ces nouvelles règles en matière de droit de grève contribuent à renforcer le rôle des collectivités territoriales en garantissant à la fois la liberté individuelle de leurs agents et la satisfaction de l’intérêt général de leur population. Toutefois, l’encadrement de ce droit reste un sujet délicat, qui requiert un équilibre précaire entre des impératifs parfois contradictoires.