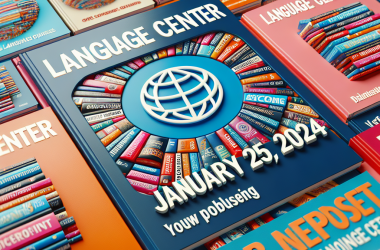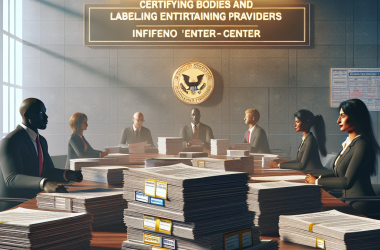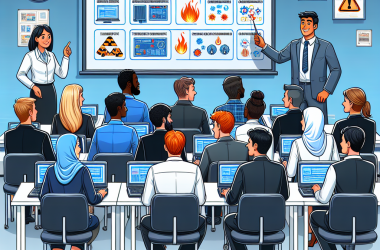À l’ère des nanotechnologies, le recours aux nanotubes de carbone multiparois (MWCNT) s’est largement répandu dans l’industrie. En effet, les propriétés physico-chimiques de ces nanotubes de carbone ont vu leurs utilisations croître pour différentes applications : électrique (conduction, résistance), thermique (stabilité haute température), ou encore chimique (capacité d’adsorption). Néanmoins, l’exposition par inhalation des salariés lors de la production, l’utilisation ou la manipulation de MWCNT soulève des questions quant à leurs effets potentiels sur la santé. En raison de leurs caractéristiques physiques, ils peuvent aisément atteindre les voies respiratoires profondes et se déposer au niveau de l’épithélium pulmonaire.
Le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) a d’ailleurs déjà classé en 2017 un CNT, le Mitsui-7 (MWNT-7), comme « cancérogène possible pour l’homme » (2B) et le comité d’évaluation des risques de l’Echa (Agence européenne des produits chimiques) étudie le classement comme cancérogènes présumés (1B) de tous les MWCNT, dont les dimensions correspondent à la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cependant, divers nanotubes ne correspondent pas à ces critères. Pour ceux-ci, un manque de données demeure quant à leur toxicité. C’est pour cette raison que les équipes de toxicologie de l’INRS conduisent des études afin d’améliorer la connaissance des effets sur la santé de toute une gamme de nanotubes.
L’INRS mène une étude pour améliorer la connaissance des effets sur la santé de différents nanotubes de carbone, mettant en évidence le potentiel cancérogène des nanotubes courts et fins.
L’étude de l’INRS met ainsi en évidence que les nanotubes de carbone longs et épais induisent cette transition (EMT) précocement et à des concentrations plus faibles que les nanotubes courts et fins. De plus, même s’il a été démontré que les effets induits par les nanotubes étaient réversibles après arrêt de l’exposition, cette réversibilité n’est pas complète et pourrait contribuer à une sensibilisation des cellules.
Pour aller plus loin, des tests in vivo réalisés sur des rats ont également montré que les deux types de MWCNT provoquaient une inflammation aiguë au niveau pulmonaire. L’exposition aux MWCNT courts et fins a quant à elle généré une inflammation chronique et une hyperplasie. Ces résultats semblent indiquer qu’il est pertinent de ne pas catégoriser les nanotubes différemment selon leur taille, et qu’il est nécessaire de manipuler les nanotubes courts et fins avec autant de précaution que les longs et épais.
En attendant les travaux de l’Echa, il convient donc de mettre en œuvre la démarche de prévention des risques chimiques en entreprise. Cette démarche repose notamment sur une identification des produits dangereux présents dans l’entreprise, quelle que soit son activité, et sur une évaluation des risques, exhaustive et rigoureuse. Cette étude a fait l’objet d’une thèse de doctorat en 2022, par Hélène Barthel, Influence de paramètres physiques de nanotubes de carbone multiparois sur leurs propriétés toxicologiques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.theses.fr/2022LORR0045.
![Illustration of [Recherche] Nanotubes de carbone : améliorer la connaissance des effets sur la santé - Actualité - INRS](https://press-gpt.olfp.net/wp-content/uploads/2024/01/c00f2dde-ae64-44fe-b3bc-35ec1a9308c1-800x800.png)