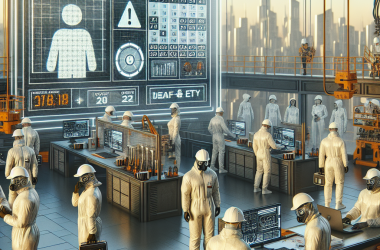Aux prud’hommes, le droit à la preuve est un principe fondamental qui permet à chaque partie impliquée dans un litige de présenter les éléments nécessaires pour défendre leur cause. Que cela concerne un employeur ou un salarié, la liberté de preuve s’applique à tous les moyens de preuve disponibles, exception faite d’une disposition légale contraire. Cependant, cette liberté n’est pas totale. En effet, les preuves présentées doivent respecter le principe de loyauté, signifiant qu’elles doivent être obtenues de manière légale et sans recours à des pratiques frauduleuses ou déloyales.
Il existe différents types de preuves couramment utilisées lors d’un litige entre employeur et salarié. La preuve écrite regroupe notamment les contrats de travail, les correspondances, les mails ou encore les SMS et autres documents en lien avec la relation de travail. Ces documents doivent être présentés en respectant les exigences de loyauté et de validité juridique. La preuve testimoniale, quant à elle, se base sur les témoignages et les attestations, qui doivent être récoltés de manière volontaire, sans contrainte ni manipulation. Les témoins doivent être informés du fait que leurs déclarations seront examinées par le juge et qu’une fausse déclaration peut entrainer des conséquences juridiques.
“Les preuves déloyales peuvent désormais être admises devant les prud’hommes si elles sont essentielles à l’exercice des droits du justiciable et ne portent pas atteinte de manière disproportionnée aux droits de la partie adverse.”
D’autres moyens de preuve peuvent également être utilisés devant les prud’hommes, comme le constat d’huissier, qui peut documenter des faits matériels ou des situations spécifiques liées au litige. Il est toutefois crucial que le constat soit réalisé dans le respect des règles de procédure et de loyauté.
Depuis le 22 décembre 2023, certaines preuves considérées comme déloyales ou illicites peuvent être admises devant le tribunal sous certaines conditions. Une preuve peut être jugée illicite lorsqu’elle porte atteinte à la vie privée du salarié et déloyale si elle a été obtenue par des manœuvres ou stratagèmes déloyaux. C’est notamment au travers de cet arrêt que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a marqué un tournant significatif en reconnaissant la recevabilité des preuves obtenues de manière déloyale sous certaines conditions strictes.
En somme, les tribunaux tolèrent désormais la présentation de preuves déloyales si elles sont essentielles à l’exercice des droits du justiciable et ne portent pas atteinte de manière disproportionnée aux droits de la partie adverse.