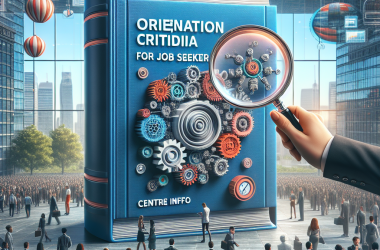Les Pfas, substances chimiques per- et polyfluoroalkylées, découvertes dans les années 1930 aux États-Unis, forment aujourd’hui une famille d’environ 10 000 substances. Ces substances, dont le pouvoir de dégradation est très faible, sont désignées également sous le terme de « polluants éternels ». Leurs propriétés sont multiples : antiadhésifs, ignifuges, antitaches, imperméabilisants, résistants aux fortes chaleurs… Elles sont présentes dans de nombreux domaines d’application et peuvent rester dans l’environnement pendant des décennies, voire des siècles. Ces composés persistants constituent non seulement un problème de santé publique, mais aussi un enjeu en milieu professionnel.
Myriam Ricaud, experte d’assistance-conseil à l’INRS, souligne les impacts néfastes des Pfas sur la santé. Elles peuvent altérer le système reproducteur et hormonal, ainsi que le système immunitaire (réduction des effets de certains vaccins). On observe également une baisse de la fertilité, des retards de puberté, de l’obésité, des lésions hépatiques et bien d’autres effets. Certaines Pfas sont déjà classées comme cancérogènes de catégorie 2 et reprotoxiques de catégorie 1B, notamment pour les cancers des testicules et du rein. Certaines Pfas agissent aussi comme des perturbateurs endocriniens.
“Les Pfas, dangereuses pour la santé publique et de multiples secteurs professionnels, sont sous surveillance réglementaire ; le nombre total de travailleurs concernés reste toutefois inconnu.”
Dans le milieu professionnel, l’exposition aux Pfas a lieu essentiellement par inhalation de poussières ou de gaz et, à un degré moindre, par voie cutanée. Ce qui représente un risque supplémentaire, c’est que ces salariés sont aussi exposés à d’autres produits chimiques, avec des effets synergétiques possibles. Les réglementations visant à restreindre ou interdire certaines Pfas se sont multipliées depuis la fin des années 1990. Certaines sont considérées comme des substances extrêmement préoccupantes dans le cadre du règlement Reach et font l’objet d’une interdiction de production et d’utilisation dans le cadre de l’autre règlement POP.
La protection des travailleurs contre les Pfas passe par plusieurs étapes. Il faut d’abord identifier toute la chaîne des Pfas : qui les produit, les utilise et les rejette. Ensuite, il faut rechercher une solution de substitution pour chaque cas. L’exposition des travailleurs doit être limitée au strict minimum s’il est impossible d’éliminer totalement le recours aux Pfas. Des mesures de protection collective doivent être mises en place, comme la ventilation et la filtration, complétées au besoin par des équipements de protection individuelle. L’éducation et la formation des employés, notamment ceux en âge de procréer, ainsi que le suivi médical des populations potentiellement exposées, sont également cruciaux.
Préoccupation récente, l’exposition aux Pfas fait l’objet de nouvelles études pour mesurer et caractériser l’exposition des travailleurs. Il est important pour les entreprises d’identifier les Pfas qu’elles produisent, utilisent, émettent et rejettent. Le plan Pfas 2023-2027, piloté par le ministère de la Transition écologique, vise à accroître les connaissances sur les Pfas, à accélérer la substitution et à limiter l’exposition.