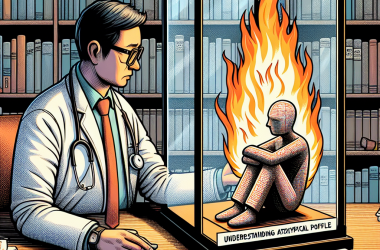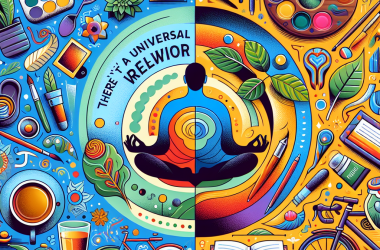Le 10 septembre 2025 a marqué un tournant significatif dans le domaine du droit du travail en France, avec une décision de la Cour de cassation qui a bouleversé la conception des heures supplémentaires. Désormais, les congés payés doivent être intégrés dans le calcul des heures supplémentaires, alignant ainsi les règles françaises sur celles du droit européen. Ce revirement fait écho à plusieurs rappels d’ordre effectués par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui soulignait qu’un salarié ne devait pas être pénalisé dans sa rémunération à cause de ses jours de repos.
Avant cette décision, seule la durée effective de travail était prise en compte. Ainsi, un salarié qui prenait un congé pendant une semaine de travail de 35 heures se voyait automatiquement privé de la possibilité de percevoir des heures supplémentaires. La CJUE a déclaré qu’une telle pratique était contraire à l’esprit de protection du droit au repos, car elle incitait les salariés à ne pas prendre leurs congés, créant ainsi une inégalité financière entre eux.
La reconnaissance du droit au repos et une rémunération équitable pour les heures supplémentaires représentent une avancée majeure pour les salariés.
Concrètement, cette décision signifie qu’un salarié qui a dépassé les 35 heures hebdomadaires, et qui a par ailleurs pris des jours de congé, pourra désormais demander le paiement des heures supplémentaires. Cette mesure concerne principalement les salariés soumis à un décompte hebdomadaire du temps de travail. Cependant, il est important de noter que les salariés au forfait jours ne sont pas concernés par cette jurisprudence, ce qui représente un défi pour les responsables des ressources humaines.
Pour les services RH, cette évolution nécessite une révision des pratiques de paie et des systèmes de gestion du temps. Les entreprises devront porter une attention particulière aux contrats de travail, aux conventions collectives et aux méthodes de décompte en vigueur pour éviter d’éventuelles erreurs. En cas de non-conformité, les salariés sont en droit de réclamer rétroactivement leurs heures supplémentaires dans la limite de trois ans, ce qui pourrait entraîner des risques contentieux non négligeables.
Enfin, cette harmonisation avec le droit européen amène à repenser la gestion globale du temps de travail. Les RH doivent veiller à ce que leurs systèmes ne découragent plus la prise de congés, inscrivant ainsi la reconnaissance du repos comme un droit fondamental. Ce changement marque une étape significative vers une reconnaissance accrue et une protection durable des droits des salariés dans le paysage du droit du travail français.