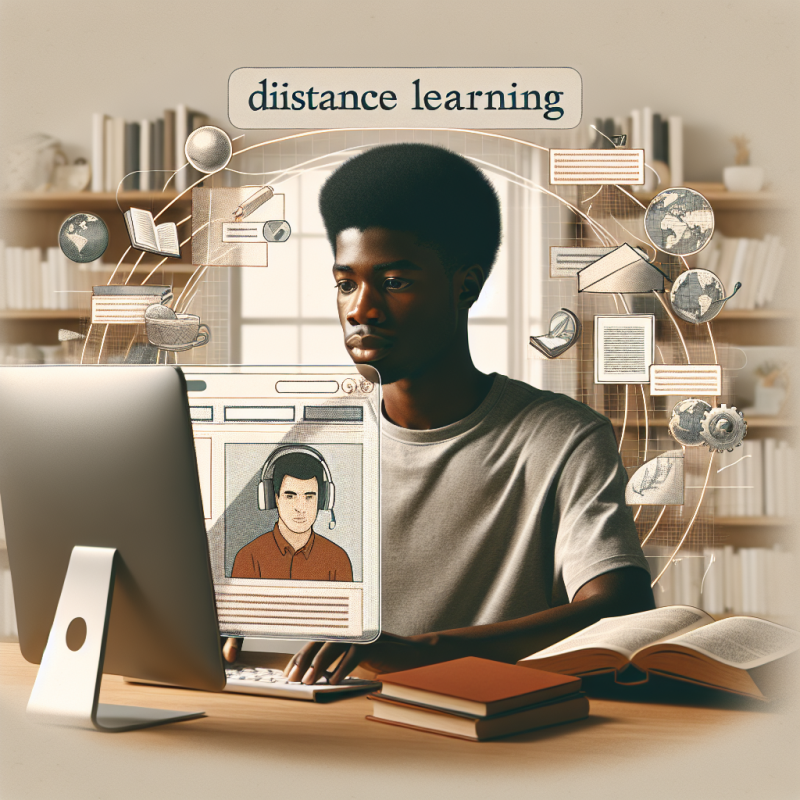La loi de finances pour 2025 ouvre la voie à une modulation du financement des CFA en fonction du recours à la formation à distance. Une mesure dont la mise en œuvre nécessite la publication d’un décret et qui soulève, selon Fouzi Fethi, responsable du pôle Droit et politique de formation à Centre Inffo, des interrogations juridiques et opérationnelles concernant la définition même de l’apprentissage.
Le 30 avril dernier, le gouvernement a dévoilé plusieurs mesures, dont l’une fait particulièrement débat : à compter du 1er juillet 2025, les formations en apprentissage dispensées à plus de 80 % à distance verront leur financement réduit de 20 %. Derrière cette décision motivée par des impératifs budgétaires se profilent des interrogations juridiques et pédagogiques : en quantifiant l’enseignement à distance, l’apprentissage, dans sa forme la plus numérique, tendrait-il à se rapprocher de la formation continue ? Surtout, comment évaluer de manière rigoureuse si une “formation” a bien dépassé le seuil des 80 % de distance par rapport au cursus de l’apprenti ?
Une sémantique floue, une frontière qui vacille ? Cette mesure, issue de la loi de finances pour 2025, nécessite un décret d’application qui s’annonce délicat, tant le texte laisse place à un flou sémantique.
En effet, la formulation retenue par le Code du travail, à l’article L. 6332-14, évoque la possibilité de moduler les financements lorsque « la réalisation des actions de formation implique des modalités de formation à distance ». Faut-il y voir une simple imprécision, ou bien une volonté assumée de brouiller la frontière entre apprentissage et action de formation ? Deux logiques de prestation historiquement distinctes Il faut dire que jusqu’ici, ces deux types de prestation étaient bien distinctes.
L’« action de formation » est définie comme un « parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel » (Art. L. 6313-2 C. trav.), tandis que l’apprentissage repose sur une « éducation alternée » articulée entre enseignements théoriques en CFA et formation pratique en entreprise (art. L. 6211-2 C. trav.). C’est cette alternance qui structure le modèle économique et social de l’apprentissage, prestation qui intègre des missions d’accompagnement, de coordination, d’inclusion — bien au-delà des seuls coûts pédagogiques.
Un financement global, indépendamment de la durée de l’enseignement C’est en ce sens que le versement des niveaux de prise en charge (NPEC) par l’opérateur de compétences (Opco) est corrélé à la durée du contrat d’apprentissage, et non aux seules heures de cours dispensées. Contrairement à la formation continue, le CFA n’est pas financé en fonction de la durée de ses enseignements, mais théoriquement pour l’ensemble de ses missions, qui vont au-delà de la fonction pédagogique : orientation, recherche d’employeur, coordination entre formateurs et maîtres d’apprentissage, information sur les droits, la mixité, etc., sans oublier les exigences de qualité liées à la certification Qualiopi (art. D. 6332-78 C. trav.).
Introduire une minoration de 20 % sur la base d’un critère purement quantitatif des enseignements — le taux de distanciel — viendrait-il infléchir ce modèle, en rapprochant l’apprentissage d’une logique de prestation plus proche de la formation continue ? Mesurer le distanciel : un enjeu financier En effet, pour appliquer cette minoration, il faudra alors mesurer la proportion des enseignements à distance dans le cadre du cursus de l’apprenti. Et c’est ici que les lignes deviennent floues.
Car si la formation continue dispose de garde-fous pour encadrer les modalités à distance — notamment l’obligation d’un accompagnement avec assistance technique et pédagogique, une information sur les activités et les temps estimés pour les réaliser, ainsi que des évaluations intermédiaires ou finales (art. D. 6313-3-1 du C. trav.) — l’apprentissage, lui, reste muet sur le sujet. Des critères de mesure inexistants Comment dès lors, un CFA qui propose un enseignement hybride peut-il calculer objectivement cette part de “formation” à distance ?