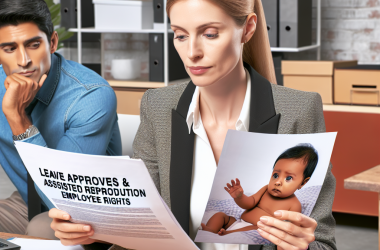La parité femmes-hommes dans les filières scientifiques et dans le monde de l’entreprise progressent lentement, mais ces avancées restent entravées par la persistance de stéréotypes tenaces. Huit femmes sur dix affirment y avoir été confrontées au cours de leur scolarité. Affirmations comme “Les maths, ce n’est pas pour les filles”. “Les jeunes femmes sont davantage destinées à des carrières littéraires”, ou “Les filles ne sont pas au niveau en mathématiques pour suivre des études scientifiques.” Sont malheureusement courantes. Selon une étude d’OpinionWay pour l’association Elles Bougent, qui plaide pour une plus grande mixité dans les secteurs industriels et technologiques, 82% des femmes intéressées par des professions techniques ont été confrontées à de tels préjugés et stéréotypes.
Ce chiffre, malheureusement stable, reste alarmant aux yeux de Valérie Brusseau, présidente de l’association. “Les stéréotypes ne changent pas suffisamment rapidement à mon goût”, regrette celle qui est également directrice dans l’industrie depuis vingt ans. Ces clichés et biais de genre sont majoritairement véhiculés par les “prescripteurs d’orientation”, pour reprendre les termes de l’association, qu’il s’agisse des parents, du personnel éducatif ou de la “société” de manière plus large. Ces attitudes peuvent dissuader les jeunes filles d’embrasser une carrière dans la science. Selon l’enquête, une femme sur cinq accepterait de renoncer à une carrière scientifique à cause de ces stéréotypes.
L’intériorisation de ces stéréotypes commence dès le plus jeune âge, lorsque les filles sont exposées dès le primaire à des commentaires allant à l’encontre de l’égalité des sexes.
Ces préjugés sont intégrés dès l’âge de 10 ans, avec des remarques liées à leur genre. Une précédente enquête démontrait l’association persistante chez les enfants de nombreux métiers au genre, les professions techniques ou l’armée étant désignées comme des “métiers masculins”.
Concernant les chiffres d’inscription, on observe une légère amélioration. Les filles représentent entre 25 et 30% des étudiants en écoles d’ingénieurs, bien que des disparités significatives existent en fonction des établissements. En douze ans, la part de femmes dans les filières scientifiques a doublé, passant de 12% en 2005 à plus d’un quart aujourd’hui. Ce choix de carrière peut s’expliquer par l’attrait des jeunes femmes pour la science, pour un secteur d’activité spécifique, ou grâce à de bons résultats scolaires. Cependant, dans leur vie professionnelle, elles ne représentent qu’un quart des métiers techniques ou scientifiques. Cela traduit une fuite des femmes vers d’autres domaines à l’issue de leurs études, un phénomène préoccupant pour Valérie Brusseau, Présidente de l’association.
Répondant à cette situation, l’association Elles Bougent travaille pour accélérer le changement. En activité depuis 2005, elle revendique 11 000 marraines et atteint chaque année 40 000 jeunes filles. À la suite de son enquête, Elle publie des recommandations pour lutter contre ces inégalités. Parmi elles, une campagne nationale sur l’égalité des sexes, une formation des enseignants pour déconstruire les stéréotypes, ou l’introduction de formations obligatoires sur l’égalité et l’inclusivité en entreprise. Moins consensuelle, elle propose également l’introduction de quotas dans les écoles d’ingénieurs, sur le modèle de la loi Rixain visant à promouvoir une plus grande parité dans les postes de direction des grandes entreprises. Seules 31% des femmes interrogées sont en faveur de l’introduction de ces quotas dans le domaine industriel.