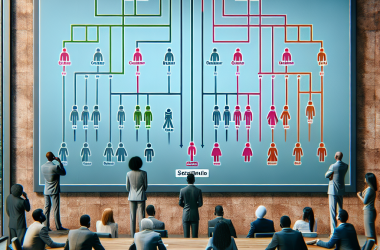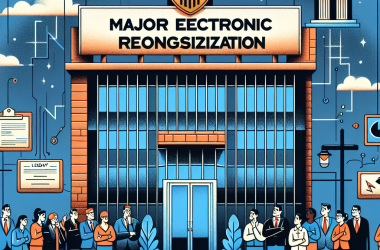Octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein, symbolisé par le célèbre ruban rose. Le lien entre le travail et le risque accru de cette maladie n’est cependant que peu abordé dans les politiques de santé publique. Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), le risque de développer un cancer du sein augmente d’environ 30 % chez les femmes ayant travaillé de nuit, un sujet souvent négligé dans les débats sur la prévention des cancers.
Ce constat alarmant soulève une question cruciale : certains cancers du sein sont-ils dus au travail ? Alors que l’opération annuelle Octobre rose met en lumière l’importance du dépistage, il semble que les autorités publiques ne prennent pas suffisamment en compte les conséquences professionnelles sur la santé des femmes. Jean-Luc Rué, responsable santé sécurité CFDT Grand Est, estime qu’il est impératif de réfléchir à la manière dont l’environnement de travail influence la santé des femmes, notamment en ce qui concerne le cancer du sein.
Les conclusions sur le lien entre travail et cancer du sein sont attendues au plus tôt fin 2026, mais une prise de conscience urgente s’impose.
Le cancer du sein reste le cancer le plus meurtrier chez les femmes en France, avec environ 12 000 décès par an. Reconnu comme un facteur cancérogène potentiel, le travail de nuit a été classé en 2007 par le Centre international de recherche sur le cancer. En parallèle, une étude de l’Inserm de 2018 a mis en lumière que le risque de développer cette maladie augmente significativement chez celles qui exercent ce type de travail plus de deux nuits par semaine pendant plus de dix ans. À ce jour, l’impact de certaines expositions professionnelles, comme celle aux produits chimiques, est encore à explorer, mais il apparait clairement que le terrain de la prévention est en grande partie inexploré.
Jean-Luc Rué a récemment exprimé son indignation lors d’une conférence : “Les conséquences du travail pouvant engendrer un sur-risque sont très rarement évoquées par les politiques publiques.” En effet, les recommandations de prévention actuelles se concentrent souvent uniquement sur des habits de vie sains, tels que l’arrêt du tabac ou une alimentation équilibrée, ignorant les facteurs de risque liés à l’activité professionnelle. Pour beaucoup, le lien entre l’exposition au travail et le développement de maladies graves reste encore un sujet tabou.
La reconnaissance du cancer du sein en tant que maladie professionnelle est un chemin semé d’embûches. La loi stipule qu’une maladie est considérée comme professionnelle lorsqu’elle est causée par une exposition régulière à un risque. Cependant, le cancer du sein n’est pas encore répertorié dans les tableaux des maladies reconnues, rendant les démarches de reconnaissance difficiles pour les femmes victimes. La première reconnaissance de ce type a eu lieu en 2023, ouvrant la voie à une discussion plus large sur le sujet.
Il est urgent de mener des études ciblées sur l’impact du travail chez les femmes. Actuellement, les recherches s’intéressent majoritairement à une population masculine, ignorants les spécificités liées aux variations hormonales qui peuvent influencer la réaction aux expositions. L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a été mandatée pour analyser les métiers et les expositions pouvant engendrer un sur-risque de cancer du sein, et les conclusions sont attendues d’ici fin 2026. Pour une meilleure prévention et une prise en charge adaptée des risques professionnels, il devient ineffable que les travaux sur la santé des femmes au travail deviennent une priorité.