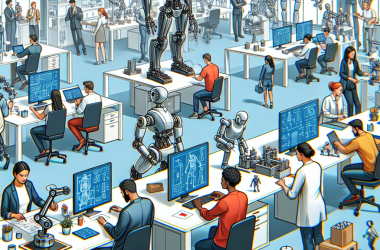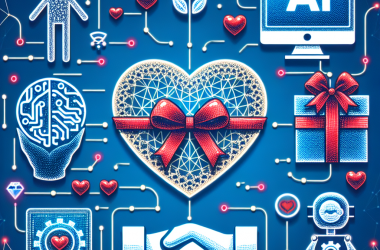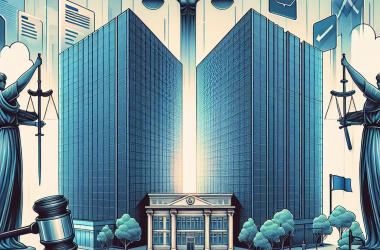Un institut de recherche lié aux Nations Unies a récemment lancé une initiative innovante en utilisant la technologie des avatars alimentés par l’intelligence artificielle pour sensibiliser le public aux questions des réfugiés. Dans le cadre d’une expérience au Centre de recherche sur les politiques de l’Université des Nations Unies (UNU-CPR), deux personnages virtuels ont été créés : Amina, une femme fictive ayant fui le Soudan et vivant dans un camp de réfugiés au Tchad, et Abdalla, un soldat fictif des Forces de soutien rapide, une milice paramilitaire soudanaise. Ces avatars sont censés permettre aux utilisateurs de discuter de la vie des réfugiés et des réalités qu’ils affrontent.
Ces échanges se déroulent sur un site web dédié à cette expérience, permettant aux utilisateurs d’interagir directement avec Amina et Abdalla. Cependant, malgré l’intérêt que suscite cette approche, des obstacles techniques ont été signalés. En effet, lorsque j’ai tenté de m’inscrire pour explorer cette partie, j’ai rencontré un message d’erreur, ce qui soulève des questions sur la facilité d’accès à ces outils innovants.
Ces avatars soulèvent des questions cruciales sur la représentation et l’autonomie des réfugiés.
Eduardo Albrecht, professeur à Columbia et chercheur senior à l’UNU-CPR, a mentionné que l’objectif de cette initiative était davantage exploratoire qu’une véritable solution pour améliorer le soutien des Nations Unies. Les étudiants et lui ont « simplement joué avec le concept », cherchant à comprendre comment ces avatars pourraient potentiellement être exploités pour renforcer les arguments en faveur des réfugiés auprès des bailleurs de fonds. Cependant, cette approche a soulevé des critiques, comme l’indiquent certaines réactions négatives recueillies lors des ateliers, où des participants ont affirmé que les réfugiés « sont tout à fait capables de s’exprimer eux-mêmes dans la vie réelle ».
Cette initiative soulève donc des questions éthiques importantes concernant l’usage de l’intelligence artificielle dans des contextes sensibles. La représentation des réfugiés par le biais d’avatars virtuels pourrait, d’une part, servir à accroître la sensibilisation, mais d’autre part, elle pourrait également minimiser leur voix réelle et leurs expériences vécues. Les réactions négatives des participants témoignent d’une prise de conscience croissante de l’importance d’entendre les récits des réfugiés eux-mêmes, plutôt que de les filtrer à travers des outils technologiques.
En conclusion, bien que l’utilisation d’avatars AI pour aborder les questions de réfugiés soit une idée intrigante et potentiellement utile, elle doit être envisagée avec prudence. Le défi réside dans la création d’un équilibre entre l’innovation technologique et le respect des réalités humaines. Les discussions autour de ce projet mettront sans aucun doute en lumière la nécessité d’impliquer les réfugiés eux-mêmes dans les dialogues qui les concernent.